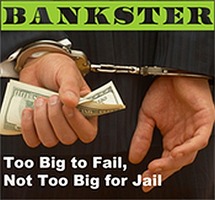
Bâtisseurs de ruines
Avec trois décennies de recul, l’assujettissement des économies au pouvoir des banquiers paraît limpide. Il procède d’une triple automutilation des Etats. La première intervient à partir des années 1970 lorsque les puissances publiques s’interdisent d’emprunter directement à leur banque centrale ; il leur faudra donc se tourner, à grands frais, vers les marchés. La deuxième découle de l’amputation des recettes fiscales. La troisième dérive de la déréglementation du commerce de l’argent. Dès lors, les institutions de crédit prennent la barre. Au début des années 1990, les profits des banques américaines dépassent ceux de l’industrie manufacturière.
Ce mouvement n’est pas inédit. Analysant la financiarisation de l’économie britannique à la fin du xixe siècle, l’économiste John Hobson notait que l’univers de la banque et de la Bourse « forme le ganglion central du capitalisme international (1) ». La City prenait le pas sur l’industrie. Mais cette évolution annonçait l’automne de la domination anglaise : le centre du capitalisme se déplaçait vers l’Amérique. Pour le sociologue Giovanni Arrighi, chacun des cycles d’accumulation qui se succèdent depuis la fin du Moyen Age se compose ainsi de deux phases d’expansion, l’une matérielle et l’autre financière. Cette dernière prélude au déclin et au basculement d’un centre vers un autre : de Gênes (XVe-XVIe siècles) aux Pays-Bas (XVIIe-XVIIIe), à la Grande-Bretagne (XIXe), aux Etats-Unis (XXe). Et, cette fois, de Wall Street à Shanghaï ?
En attendant, les gouvernements occidentaux héritent d’une même équation : moins de recettes, plus de besoins, une dépendance accrue vis-à-vis des créanciers. La plupart acceptent comme une fatalité que le système fonctionne à l’envers. En théorie, les banques conçues comme des pompes à crédit financent l’économie ; en pratique, l’économie finance des conglomérats bancaires actifs dans tous les métiers du capital : dépôt, investissement, ingénierie financière, assurance (voir les infographies). L’emprise qu’ils exercent sur notre quotidien — vivre sans compte en banque, chose courante il y a seulement quarante ans, n’est plus guère envisageable — se transpose à chaque échelon de l’activité économique. Ce renversement ne fut pas immédiatement perceptible. Longtemps on mit sur le compte des « excès » de l’innovation le surgissement de crises apparemment sans lien : faillite des caisses d’épargne américaines à la fin des années 1980, naufrage de la banque Barings en 1995, effondrement frauduleux en 2001 de l’électricien Enron devenu courtier en produits dérivés. Par son ampleur et sa violence, la crise des subprime a fait apparaître depuis 2007 le fil rouge qui relie ces jalons. Elle révèle à l’échelle planétaire l’état du système financier : « Un pur et colossal système de jeu et de tripotages (2) », d’après le mot de Marx.
Aux Etats-Unis, en Espagne, en Irlande, les banques avaient spéculé sur la hausse infinie de l’immobilier. Elles ont perdu. Lestées par leurs dettes irrécouvrables, mais jugées trop centrales pour couler sans entraîner avec elles l’ensemble de l’économie, elles ont transféré leurs pertes aux Etats. Lesquels, plombés à leur tour, présentent la note aux populations sous la forme de plans d’austérité. C’est que la spéculation n’est pas qu’un jeu d’esprit. A la base des montages les plus entortillés se trouve toujours un actif réel (un « sous-jacent », disent les courtiers) : une valeur, c’est-à-dire du travail humain. Quand la pyramide s’écroule, quelqu’un doit payer. Faire travailler les peuples pour rembourser les banques, tel est le sens de la rigueur décrétée par les gouvernements.
En août dernier, la Banque centrale européenne (BCE) détaille les conditions de son aide à l’Italie. « En premier lieu, raconte Le Figaro, elle demande à M. Silvio Berlusconi de procéder par décret, d’application immédiate, et non par projet de loi, que le Parlement met toujours du temps à approuver. » Court-circuiter les Parlements ne suffit pas. « S’agissant du code du travail en vigueur depuis 1970, la BCE demande de rendre plus flexibles les procédures de licenciement et de privilégier les accords au sein des entreprises aux conventions sectorielles négociées à l’échelon national. C’est un point capital : M. Sergio Marchionne, le patron de Fiat, ne cesse de dénoncer la rigidité de l’embauche et des licenciements (3). » Que des banquiers centraux somment M. Berlusconi, troisième fortune d’Italie, d’accéder aux requêtes du patronat ne comporte au fond rien de très surprenant. Les classes dirigeantes de Dublin, Athènes, Madrid, Lisbonne ont elles aussi accepté sans trop rechigner leur mise sous tutelle. Leurs intérêts n’en pâtiront pas... Aussi, l’erreur serait de considérer la puissance dévastatrice des banques hors de la configuration sociale qui l’engendre.
Comme l’alchimie, le commerce débridé de l’argent repose sur le mythe de la création de richesse ex nihilo. Il ne s’amende pas, il ne se régule pas. Il s’effondre.
Pierre Rimbert.
N.D.L.R
Vous allez dire que j'insiste sur ce sujet. Mais je suis désolé, c'est le plus important de tous. Votre vie actuelle, et la mienne en dépendent complètement.
Ce qui me rend furieux, c'est que les hommes politiques français, de quelque bord qu'ils soient, ignorent superbement ce sujet. A part la pétition récente d'Attac personne ne bouge et surtout pas les socialistes, tous occupés à polir leur égo dans le cadre de la primaire socialiste.
Les banksters dorment dormir tranquilles : les France ne les gênera pas dans leur odieux commerce. Les seuls à avoir bougé, à ce jour, sont les anglais. Voir article récent sur ce site. Un comble ! Ce sont les plus libéraux des européens qui veulent (enfin) mettre un peu d'ordre dans le sale business des banques.
Comme je ne peux croire que nos politiques sont stupides, une conclusion s'impose : ils sont tous pourris. Nous le présumions depuis longtemps. Nous en avons maintenant la preuve éclatante.
Quant aux français de base, qui n'ont pas l'air de s'émouvoir beaucoup de ces problèmes, quand les privés auront perdu leur boulot ou/et leurs économies, quand les fonctionnaires auront perdu leurs retraites, ils auront tout loisir de pleurer sur leur cécité coupable.
La croissance, la reprise, la rigueur, les réformes, ne sont plus à l'ordre du jour. Si on n'arrête pas les banquiers dans les meilleurs délais dans leur folle course vers l'abîme, c'est la catastrophe assurée, à brève échéance.
Avec trois décennies de recul, l’assujettissement des économies au pouvoir des banquiers paraît limpide. Il procède d’une triple automutilation des Etats. La première intervient à partir des années 1970 lorsque les puissances publiques s’interdisent d’emprunter directement à leur banque centrale ; il leur faudra donc se tourner, à grands frais, vers les marchés. La deuxième découle de l’amputation des recettes fiscales. La troisième dérive de la déréglementation du commerce de l’argent. Dès lors, les institutions de crédit prennent la barre. Au début des années 1990, les profits des banques américaines dépassent ceux de l’industrie manufacturière.
Ce mouvement n’est pas inédit. Analysant la financiarisation de l’économie britannique à la fin du xixe siècle, l’économiste John Hobson notait que l’univers de la banque et de la Bourse « forme le ganglion central du capitalisme international (1) ». La City prenait le pas sur l’industrie. Mais cette évolution annonçait l’automne de la domination anglaise : le centre du capitalisme se déplaçait vers l’Amérique. Pour le sociologue Giovanni Arrighi, chacun des cycles d’accumulation qui se succèdent depuis la fin du Moyen Age se compose ainsi de deux phases d’expansion, l’une matérielle et l’autre financière. Cette dernière prélude au déclin et au basculement d’un centre vers un autre : de Gênes (XVe-XVIe siècles) aux Pays-Bas (XVIIe-XVIIIe), à la Grande-Bretagne (XIXe), aux Etats-Unis (XXe). Et, cette fois, de Wall Street à Shanghaï ?
En attendant, les gouvernements occidentaux héritent d’une même équation : moins de recettes, plus de besoins, une dépendance accrue vis-à-vis des créanciers. La plupart acceptent comme une fatalité que le système fonctionne à l’envers. En théorie, les banques conçues comme des pompes à crédit financent l’économie ; en pratique, l’économie finance des conglomérats bancaires actifs dans tous les métiers du capital : dépôt, investissement, ingénierie financière, assurance (voir les infographies). L’emprise qu’ils exercent sur notre quotidien — vivre sans compte en banque, chose courante il y a seulement quarante ans, n’est plus guère envisageable — se transpose à chaque échelon de l’activité économique. Ce renversement ne fut pas immédiatement perceptible. Longtemps on mit sur le compte des « excès » de l’innovation le surgissement de crises apparemment sans lien : faillite des caisses d’épargne américaines à la fin des années 1980, naufrage de la banque Barings en 1995, effondrement frauduleux en 2001 de l’électricien Enron devenu courtier en produits dérivés. Par son ampleur et sa violence, la crise des subprime a fait apparaître depuis 2007 le fil rouge qui relie ces jalons. Elle révèle à l’échelle planétaire l’état du système financier : « Un pur et colossal système de jeu et de tripotages (2) », d’après le mot de Marx.
Aux Etats-Unis, en Espagne, en Irlande, les banques avaient spéculé sur la hausse infinie de l’immobilier. Elles ont perdu. Lestées par leurs dettes irrécouvrables, mais jugées trop centrales pour couler sans entraîner avec elles l’ensemble de l’économie, elles ont transféré leurs pertes aux Etats. Lesquels, plombés à leur tour, présentent la note aux populations sous la forme de plans d’austérité. C’est que la spéculation n’est pas qu’un jeu d’esprit. A la base des montages les plus entortillés se trouve toujours un actif réel (un « sous-jacent », disent les courtiers) : une valeur, c’est-à-dire du travail humain. Quand la pyramide s’écroule, quelqu’un doit payer. Faire travailler les peuples pour rembourser les banques, tel est le sens de la rigueur décrétée par les gouvernements.
En août dernier, la Banque centrale européenne (BCE) détaille les conditions de son aide à l’Italie. « En premier lieu, raconte Le Figaro, elle demande à M. Silvio Berlusconi de procéder par décret, d’application immédiate, et non par projet de loi, que le Parlement met toujours du temps à approuver. » Court-circuiter les Parlements ne suffit pas. « S’agissant du code du travail en vigueur depuis 1970, la BCE demande de rendre plus flexibles les procédures de licenciement et de privilégier les accords au sein des entreprises aux conventions sectorielles négociées à l’échelon national. C’est un point capital : M. Sergio Marchionne, le patron de Fiat, ne cesse de dénoncer la rigidité de l’embauche et des licenciements (3). » Que des banquiers centraux somment M. Berlusconi, troisième fortune d’Italie, d’accéder aux requêtes du patronat ne comporte au fond rien de très surprenant. Les classes dirigeantes de Dublin, Athènes, Madrid, Lisbonne ont elles aussi accepté sans trop rechigner leur mise sous tutelle. Leurs intérêts n’en pâtiront pas... Aussi, l’erreur serait de considérer la puissance dévastatrice des banques hors de la configuration sociale qui l’engendre.
Comme l’alchimie, le commerce débridé de l’argent repose sur le mythe de la création de richesse ex nihilo. Il ne s’amende pas, il ne se régule pas. Il s’effondre.
Pierre Rimbert.
N.D.L.R
Vous allez dire que j'insiste sur ce sujet. Mais je suis désolé, c'est le plus important de tous. Votre vie actuelle, et la mienne en dépendent complètement.
Ce qui me rend furieux, c'est que les hommes politiques français, de quelque bord qu'ils soient, ignorent superbement ce sujet. A part la pétition récente d'Attac personne ne bouge et surtout pas les socialistes, tous occupés à polir leur égo dans le cadre de la primaire socialiste.
Les banksters dorment dormir tranquilles : les France ne les gênera pas dans leur odieux commerce. Les seuls à avoir bougé, à ce jour, sont les anglais. Voir article récent sur ce site. Un comble ! Ce sont les plus libéraux des européens qui veulent (enfin) mettre un peu d'ordre dans le sale business des banques.
Comme je ne peux croire que nos politiques sont stupides, une conclusion s'impose : ils sont tous pourris. Nous le présumions depuis longtemps. Nous en avons maintenant la preuve éclatante.
Quant aux français de base, qui n'ont pas l'air de s'émouvoir beaucoup de ces problèmes, quand les privés auront perdu leur boulot ou/et leurs économies, quand les fonctionnaires auront perdu leurs retraites, ils auront tout loisir de pleurer sur leur cécité coupable.
La croissance, la reprise, la rigueur, les réformes, ne sont plus à l'ordre du jour. Si on n'arrête pas les banquiers dans les meilleurs délais dans leur folle course vers l'abîme, c'est la catastrophe assurée, à brève échéance.





 Management à la Française : Pourquoi ça coince toujours ?
Management à la Française : Pourquoi ça coince toujours ?